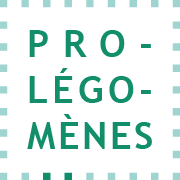Prolégomènes
Le syntagme « anthropologie clinique » a été utilisé pour la première fois par le psychiatre et psychanalyste Belge Jacques Schotte en 1974 (Duruz, 2008)[1] Cette utilisation par Schotte fait suite à une tradition importante qui trouve le début de son histoire dans les travaux de Ludwig Binswanger et Viktor von Weizäcker qui s’inspirent eux-mêmes des théorisations de M. Heidegger, M. Scheler et K. Jaspers (Lekeuche, 2008)[2]. Ainsi, comme le propose Nicolas Duruz, l’anthropologie clinique est « chevillée dans le courant de la phénoménologie allemande (E. Husserl et M. Heidegger) et portée tout particulièrement par quatre grands psychiatres-philosophes du milieu du XXe siècle (L. Binswanger, E. Minkowski, E. Straus et V. von Gebsattel), elle cherche à constituer une psychiatrie et une médecine scientifiques, qui puissent intégrer l’expérience vécue du patient. » (op. cit., Duruz).
Sa préhistoire remonte à l’antiquité grecque, si l’on suit Henri Mésot, qui note que Binswanger met en exergue de « Rêve et Existence » l’épigraphe de Kierkegaard : « Il convient plutôt de s’attacher à ce que signifie : être un homme ». Cette remarque fait penser à Philippe Lekeuche que « ce souci habitait déjà la pensée des Grecs, y compris les présocratiques. Il nous faut donc insister sur l’idée que le concept d’anthropologie clinique s’inscrit au cœur d’une grande tradition qui forme l’axe central de la pensée occidentale sur l’homme. » (op. cit., Lekeuche).
Cette tradition psychiatrique de l’anthropologie clinique est avant tout celle de cliniciens qui ne voulaient pas séparer la clinique d’une réflexion anthropologique.
Mais il existe une autre tradition, cette fois porté par les anthropologues qui s’intéressent à la maladie et à la santé. Marc-Adélard Tremblay, distingue l’anthropologie de la clinique de l’anthropologie clinique à proprement parler qui représente chacune deux champs d’études d’une même discipline, l’anthropologie de la santé ou anthropologie médicale.
Ainsi, « l’anthropologie clinique est davantage orientée vers l’utilisation des connaissances anthropologiques dans le diagnostic et la résolution des « problèmes de santé », que ceux-ci soient à caractère purement somatique ou qu’ils se classent dans les catégories des maladies psychosomatiques et des maladies de civilisation, l’anthropologie de la clinique appartient à l’univers traditionnel de la recherche anthropologique à caractère fondamental et porte essentiellement sur les modes thérapeutiques comme sur les processus d’intervention des différentes catégories professionnelles. Si l’anthropologie clinique relève d’une action qui résulte d’un transfert de connaissances, l’anthropologie de la clinique, au contraire, est le champ qui les produit et les fonde sur une démarche rigoureuse. »[3] (Tremblay, 1991). En fait, deux courants sont observables en anthropologie de la santé. Le premier vient des travaux ethno-anthropologiques sur « la phénoménologie de la santé, de la maladie et de la mort, cherchant à travers elle à comprendre les visions du monde, les systèmes de croyance et les explications de la maladie. » (Ibid.). En suivant, cette tradition a trouvé à se poursuivre dans des programmes de santé publique mis en œuvre dans des pays en voie de développement.
Le deuxième courant qui a largement influencé l’anthropologie de la santé est celui de la psychiatrie sociale, un champ qui émerge dans les années cinquante en Angleterre et aux États-Unis. Pour Trembley, « cette sous-discipline psychiatrique visait à mieux comprendre l’influence des facteurs environnementaux, psychosociologiques, socio-économiques et socioculturels sur l’incidence et la prévalence des désordres psychiatriques. » (Ibid.). L’utilisation d’études épidémiologiques, permettait d’établir des taux de prévalence des maladies psychiatriques selon le sexe, la catégorie d’âge, le statut socio-économique ou le statut de classe, le degré de scolarité, l’appartenance ethnique, l’affiliation religieuse, etc. toutes ces variables devant discriminer les états affectifs individuels en tenant compte du degré d’organisation sociale et de la qualité de la vie des unités sociales concernées pour rendre compte des différenciations environnementales. Le modèle théorique de l’école de Chicago [4] servait de paradigme dans l’examen du niveau communautaire d’analyse tandis que les études en sociologie, en psychologie et en psychologie sociale permettaient l’utilisation d’indicateurs individuels en vue d’établir des relations concomitantes entre, d’une part, les comportements pouvant être qualifiés de pathologiques et, d’autre part, l’éventail des statuts sociaux de l’individu, y compris sa position de classe (Hollingshead et Redlich 1958) (Ibid.). Des anthropologues étaient intégrés à ces différents programmes de recherche en épidémiologie psychiatrique. L’anthropologie de la santé connaîtra ensuite un développement au Québec et en Europe. Au Canada, notamment par le travail de Marc-Adélard Trembley et Jean Benoist, ce dernier contribua à la diffusion et au développement de la discipline en France.
En Europe francophone, la notion d’anthropologie clinique connaîtra, chez les cliniciens un regain d’intérêt vers la fin des années quatre-vingt, notamment à la suite de Schotte, mais pas uniquement. Nous notions avec Duruz[5] qu’un point commun entre les différents auteurs contemporains qui ce sont explicitement référés à la notion d’anthropologie clinique consistait à alerter et à opérer une résistance dans le champ clinique face à la montée des réductionnismes neurocognitivistes et des pratiques comportementalistes. (Escots, Duruz, 2015)
C’est particulièrement le cas d’Olivier Douville, psychologue clinicien et psychanalyste. Pour Douville, « la démarcation entre psychanalyse et anthropologie clinique est peu perceptible, tant pour lui la « clinique » s’identifie à la clinique psychanalytique » (Ibid.). Il en appelle à un dialogue entre clinique et anthropologie pour éviter les errances auxquels certains cliniciens pourraient se livrer. (Douville, 2012). Ainsi « L’anthropologie clinique n’est pas à situer alors comme une sous-discipline de l’anthropologie trouvant à se loger dans un découpage doctrinal pré établi aux côtés de l’anthropologie culturelle, sociale, politique, etc. Elle consiste tout particulièrement en l’examen clinique et critique des catégories existentielles qui se révèlent dans les grandes déchirures d’une vie singulière comme d’une vie collective, surtout dans les expériences de ruptures des symbolisations culturelles du sexuel et de la mort. Cette anthropologie sait faire place à l’écart entre le discours social et le discours du sujet tant ce dernier ne s’y trouve pas totalement prescrit. Recentrés sur la dimension de l’étant en tension et en devenir, les grands paradigmes de l’anthropologie clinique font, alors, toute la place à une philosophie des structures de chaque existence humaine : le monde, l’espace au temps lié, le corps, le destin des interdits, des structures rituelles et narratives de symbolisation des alliances et des filiations. Cette anthropologie ne saurait déboucher sur une vision abstraite, neutre et asexuée de l’humain. »[6] (Douville, 2013)
Il s’agirait ainsi, au travers des souffrances psychiques que présente le sujet d’analyser les catégories anthropologiques qui s’y révèlent. Nous sommes bien dans le prolongement de la démarche de Freud qui appelait dans sa préface de « Totem et tabou », a créer « des liens entre ethnologues, linguistes, folkloristes () et psychanalystes »[7] L’idée étant que l’inconscient vient trouer le savoir des anthropologues, et par conséquent, « les sciences sociales ne peuvent que s’enliser, à reproduire la méconnaissance de l’inconscient, inclus dans leur objet même. Il s’agit bien pour Freud, de formuler une demande de la psychanalyse à l’anthropologie et de constituer une demande de l’anthropologie à la psychanalyse. »[8] (Assoun, 2011) On sait que Lacan réservait à tout projet d’anthropologie psychanalytique « une fin de non-recevoir personnelle et formelle. » (Ibid., p. 71) Mais dans ces entrelacs entre anthropologie et psychanalyse s’agit-il, pour ceux qui de près ou de loin s’en réclame, d’anthropologisation de la psychanalyse ou de psychanalysation de l’anthropologie ?
Ce faisant, Douville entend que l’anthropologie clinique envisage le sens pathique dans une épistémologie à la fois structuraliste, phénoménologique et historique. « Le sujet anthropologique () force la dimension du pathique, la fait rentrer de plein droit dans le champ disciplinaire. S’interroger sur le sens pathique de la rencontre avec l’altérité inscrit l’étude des liens, montages et fractures des rapports de l’identité à l’altérité dans l’examen de leur densité. Laquelle est multifactorielle : structurale, phénoménologique et historique. ». Cette triple perspective se retrouve fréquemment dans les propositions qui en appellent à l’anthropologie clinique. Toutefois, au-delà des choix des paradigmes (structuraux, phénoménologiques, historiques, etc.) pour que l’anthropologie clinique ne soit pas une sous-discipline de l’anthropologie, comme Douville semble l’envisager, il est indispensable qu’elle s’installe d’emblée dans une interdisciplinarité la plus large possible, afin que les dimensions où se déploie l’humain puissent s’envisager. De la même manière qu’à l’instar de ce que Schotte faisait, l’interdisciplinarité concerne aussi toutes les dimensions pathiques, en s’ouvrant à différents modèles cliniques. Au risque qu’à défaut d’être sous-discipline de l’anthropologie, elle ne devienne une sous-discipline de la psychologie clinique psychanalytique. De fait, pour ne pas être sous-discipline, elle doit se constituer dans une démarche transdisciplinaire.[9]
Deux autres cliniciens psychanalystes influencés par Schotte ont utilisé la référence à l’anthropologie clinique : Robert Steichen et Régnier Pirard.
Robert Steichen a proposé en 2001 un programme de recherches pluridisciplinaires en sciences humaines cliniques, dont l’objectif est de contribuer à une « anthropologie clinique d’inspiration psychanalytique » (Steichen, 2004)[10]. Psychiatre et psychanalyste, Robert Steichen inscrit sa démarche dans le champ de l’anthropologie de la santé en proposant d’opposer une clinique fonctionnelle qui fonde son efficacité sur l’élimination des symptômes à une clinique de l’homme malade, qui donne sens à sa maladie. (op. cit., Escots, Duruz). Ou plutôt, il s’agit de prendre position entre clinique du patient et clinique du sujet. « La première clinique s’attaque à la maladie en s’appuyant sur le diagnostic savant. La seconde clinique, sans négliger diagnostic et thérapeutique, soutient le sujet malade en faisant appel à sa représentation singulière de son mal et à ses ressources propres. » (Ibid.) Dans la perspective de l’anthropologie clinique, envisagé par Steichen, le patient est activement impliqué dans son traitement. La position de Steichen entre ces deux formes de cliniques reste nuancée : « Il y a place pour un vaste éventail de positions intermédiaires entre une clinique du patient et du sujet. Et aussi pour des changements de position en fonction des impératifs de la réalité contextuelle et de l’histoire individuelle des cliniciens. » (op. cit., Steichen). Le champ concret de cette anthropologie clinique, concerne « les personnes, familles et collectivités, en souffrance psychique », et de fait l’ensemble des individus souffrant de « troubles psychopathologiques ». Mais plus largement, son champ s’étend aux « personnes souffrant de dysfonctions sexuelles, de troubles de l’identité sexuelle, de conflits conjugaux, de tensions sociales, de syndromes post-traumatiques, de situations d’incarcération ou de soins forcés, () Il s’agit encore de sujets confrontés à la perte de leurs références identitaires du fait de leur déplacement suite à des violences politiques ou raciales, de faits de guerre ou de catastrophes naturelles, réfugiés installés dans des camps ou demandeurs d’asile politique, ainsi que des personnes immigrées ou en cours de transculturation. » (Ibid.). Steichen précise ainsi le champ d’application de l’anthropologie clinique qui s’étend au-delà de la stricte clinique psychiatrique ou psychothérapeutique pour s’ouvrir à d’autres champs d’intervention. Il définit également la méthodologie de recherche de l’anthropologie clinique : centré sur l’humain et l’interdisciplinarité, en recherchant « la co-construction du modèle de recherche entre le chercheur et la personne qui accepte de partager son témoignage. » (Ibid.). Bien qu’explicitement d’inspiration psychanalytique, en indiquant que son approche méthodologique « privilégie l’étude du développement de la réalité subjective, et des interactions du sujet avec lui-même et son environnement » (Ibid.), l’anthropologie clinique s’ouvre à une perspective phénoménologique et écosystémique.
Régnier Pirard, est un disciple à la fois de Jacques Schotte et du linguiste et épistémologue Jean Gagnepain. En 1991, il publie « Prolégomènes à une anthropologie clinique » qui vise à promouvoir un renouveau de la métapsychologie freudo-lacanienne. Il s’agit de clarifier les postulats épistémologiques de la psychanalyse par une confrontation aux apports de Gagnepain. (op. cit., Escots, Duruz). Il revisite ainsi, les grandes catégories anthropologiques, comme la mémoire, le langage, l’inconscient, le désir, la paternité, le rêve, etc. et aborde les grandes catégories psychopathologiques de la névrose, de la psychose et de la perversion. La démarche est critique et vise plus à renouveler les piliers de la doctrine psychanalytique qu’à définir ceux de l’anthropologie clinique. Et notamment sur la relecture freudienne de Lacan. Ainsi, il pose en avant-propos : « Comment tirer parti d’incontestables apports des théories de Lacan sans pour autant fétichiser tout l’appareil conceptuel qu’il propose ? Comment apprécier les percées novatrices tout en résistant aux forçages épistémologiques dont témoigne ad nauseam l’incroyable inflation du signifiant et son cortège d’objet a ? » Pirard, C’est dans l’anthropologie linguistique de Gagnepain, introduit par Schotte que Pirard va trouver les éléments nécessaires à son entreprise. Celle-ci a le mérite de dégager un ensemble de concepts psychanalytiques ressaisis à partir de leurs réalités cliniques dans une perspective anthropologique. Ainsi repensé, ces concepts permettent de nourrir la réflexion épistémologique de l’anthropologie clinique.
Le linguiste et épistémologue Jean Gagnepain a conçu pour les sciences humaines une ambition épistémologique de très grande envergure (op. cit. Escots, Duruz, 1991). Son projet propose une épistémologie robuste qu’il considère apte pour envisager une refonte des sciences humaines. Ce projet scientifique, s’inscrit dans une démarche qui n’entend pas tenir l’humain à part des objets du monde naturel, ni vouloir le naturaliser. Pour lui, si « l’on veut faire des sciences de l’homme, il faut traiter l’homme comme on traite l’objet de nature tout en respectant sa spécificité, c’est-à-dire le seuil différentiel. L’homme n’est pas un animal, mais () il le reste. Autrement dit, il n’est pas question de nier notre animalité, mais il est question surtout de dire que notre animalité () nous permet des choses auxquelles le chimpanzé n’a pas accès. Et c’est précisément à cette différence-là qu’il faut consacrer la réflexion si on veut prendre conscience de la ligne à suivre () en ce qui concerne les sciences humaines. » (Gagnepain J., 1994, p. 19)
Gagnepain, a proposé un modèle théorique complet et cohérent, où la clinique neurologique et psychiatrique se propose d’être la voie pour une transformation profonde des sciences humaines (Gagnepain, 1985). Son projet s’inscrit avant tout dans une démarche scientifique qui prend l’humain comme objet et qui cherche dans l’étude clinique (notamment celle des aphasies) une forme de vérification expérimentale, d’où la notion d’anthropologie clinique pour qualifier sa « Théorie de la Médiation » (Ibid.). Dans cette théorie, l’humain « médiatise » sa relation au monde selon quatre formes de rationalité culturelles : le Signe, l’Outil, la Personne et la Norme. Si celle-ci nourrit des liens avec la psychanalyse (Freud, Lacan), elle s’en démarque dans l’établissement même de ses fondations. Notamment en ce qui concerne le concept d’inconscient, que Gagnepain préfère désigner par l’implicite, du fait qu’il le découpe selon quatre plans de rationalité. Freud et Gagnepain, au travers des notions d’inconscient et d’implicite exprime le fait que l’humain « est irréductible à la saisie immédiate de ses performances, et qu’il fallait pour l’expliquer approfondir la saisie qu’on s’en donnait afin de faire émerger sous le phénomène non pas le noumène () mais plus exactement le système ou la structure sous-jacente apte à rendre compte de la manière () de se comporter, or cette structure, et c’est cela qui est important dans la théorie de la médiation, n’est pas considéré () comme un autre monde, un super-monde, mais simplement comme l’intrusion dans l’immédiat d’un « non immédiatement saisissable », d’un médiat, qu’il soit structure, praxis ou implicite. » (Ibid., pp 31-32)
À la suite de Saussure, Marx et Freud, Gagnepain entend faire une rupture épistémologique avec les sciences qui ne prendraient que la nature comme objet. Pour autant, sa différence avec eux tient à la place qu’il accorde au « logos ». « En outre, je reproche à tous les trois, même à Marx, d’avoir donné au langage une importance exceptionnelle et indue. » (Ibid., p. 33). Comme nous l’avons vu, chez Gagnepain, le logos se projette en quatre plans de rationalité. Le plan I est celui de la rationalité logique, logos (Signe), le plan II celui de la rationalité technique tropos (Outils), le plan III celui de la rationalité ethnique nomos (Personne) et enfin le plan IV celui de la rationalité éthique diké (Norme). « Notre propre rupture, par différence d’avec ceux qui nous ont précédés, refuse de réduire la rationalité à une seule modalité. » (Ibid., p. 34).
Bien que Gagnepain ne fasse pas référence à Cassirer dans son introduction à la Théorie de la Médiation, d’une certaine manière, cette hypothèse rejoint le point de vue du philosophe allemand sur la place du langage comme forme symbolique dans la culture. Jean Lassègue qui entreprend depuis plusieurs années une lecture critique de Cassirer écrit à propos de la place du langage comme origine des formes symbolique et donc de la culture dans l’œuvre du philosophe allemand : « la place du langage conçu comme fondement pour les formes symboliques en général reste à tout jamais ouvert : il ne s’agit donc pas de répondre à la question de savoir si le langage joue ou non le rôle de fondement pour les formes symboliques, mais de remarquer seulement qu’il y va de la nature intrinsèquement mythifiante du langage que la question du fondement se pose à son propos. Si la problématique du fondement a bien partie liée avec la nature mythifiante du langage, alors une solution qui élèverait purement et simplement le langage au rang de fondement pour les formes symboliques ne permettrait pas de prendre en compte la place ambivalente du langage dans le projet général d’une philosophie des formes symboliques, et ne permettrait pas non plus d’analyser comment cette ambivalence le fait intervenir de manière spécifique dans le rapport qu’il entretient, à chaque fois, avec d’autres formes symboliques. » (Lassègue, 2016, pp 148-149). Lassègue à la suite de Cassirer, envisage les formes symboliques (Mythe, Langage, Science, Technique, Arts, Droit, Économie, Politique, etc..) comme des modalités de donation de sens de l’expérience humaine pour lesquels le langage tient une place unique sans pour autant tenir lieu d’origine. Il considère « les formes symboliques comme autant de plans d’expression spécifiques travaillés par des normes qui n’ont pas directement pour finalité l’auto-réflexion de la conscience par elle-même mais la socialité comme telle. » (Ibid., p. 149).
Le projet de Jacques Schotte (1928-2007) « constitue une des sources essentielles de l’anthropologie clinique » (op. cit. Escots, Duruz). Ce psychiatre, psychanalyste et phénoménologue belge a posé les bases d’une science apte à repenser la nosographie psychiatrique. C’est au contact des philosophes H. Maldiney et A. Deese, assistant de Heidegger, des psychiatres psychanalystes L. Binswanger, J. Lacan, et F. Tosquelles et du médecin psychopathologue L. Szondi, que Schotte a construit son anthropopsychiatrie.
« Selon Schotte, Freud a eu le mérite de sortir la psychiatrie du modèle médical naturalisant (une nosographie de l’herbier, à la Linné, préfiguration du DSM !) et de l’ancrer dans un registre proprement humain. Le pathologique n’est pas à appréhender dans son opposition à la santé, mais bien plutôt comme nous révélant le registre proprement humain. En proposant à plusieurs reprises de considérer la maladie mentale comme une exagération d’un comportement qu’on trouve en tout homme dit « normal » ou vivant dans le quotidien, Freud pose le pathologique dans une relation dialectique à la santé. » (Ibid.).
On se rappelle que pour Freud, le psychotique se situe dans son rapport à la réalité de façon excessive, sans limite et autoplastique, là où à l’opposé, le névrosé, est tout aussi excessif dans ses inhibitions et son hyperadaptation. « L’hystérie, suggère-t-il, peut s’entendre comme une œuvre d’art ratée, et la névrose obsessionnelle comme une religion maladive. Ou encore, les pathologies narcissiques sont une voie royale pour la compréhension de ce qu’est le « moi ». » (Ibid.).
Cette conception de la psychopathologie, qui chez Freud, s’envisage dans un continuum entre santé et maladie, normal et pathologique, trouve ses fondements dans la théorie pulsionnelle qu’il cherche à construire. Pour Freud, « la notion d’instinct, dans ce qu’elle comporte de trop biologique quant à ses déterminations, est subsumée et dépassée dans celle de pulsion (Trieb), « concept limite, selon ses termes, entre le psychisme et le biologique ». La pulsion peut être ainsi pensée d’après Schotte comme un concept pleinement anthropologique, dans la mesure où elle renvoie à la « poussée », au « besoin » biologique, dont l’excessive indétermination chez l’homme est à l’origine de ses productions pulsionnelles et culturelles. Plus tard, Lacan développera dans ce sens la notion de désir inconscient. Cette distinction de l’homme par rapport à l’animal fonde la spécificité des troubles et maladies psychiques et ouvre ainsi la voie à une psychiatrie strictement humaine » (Ibid.).
Schotte, à la suite de Freud et Szondi, envisage les maladies mentales comme avant tout des maladies pulsionnelles, les considérant par conséquent comme des perturbations directement anthropologiques.
Une telle approche de la pathologie influence la posture du clinicien : en effet, soignant et soigné ne sont pas étrangers du fait des manifestations psychopathologiques, il partage une même communauté de destin. Ce point fait convergence avec le mouvement de la psychothérapie institutionnelle pour laquelle il faut soigner (prendre soin), l’institution et son personnel tout autant que les malades qui y sont accueillis.
L’apport de la psychanalyse freudienne n’est pas seul pour faire cette ouverture anthropologique à la clinique, celui de la phénoménologie sera tout aussi déterminant. Influencé par l’enseignement d’Henri Maldiney, « il va travailler entre autres avec la notion de pathique, forgée par le médecin-neurologue et philosophe-phénoménologue Viktor von Weizsäcker, qui entend signifier par là une dimension passionnelle et critique constitutive de tout vivant. Selon une telle approche, toute pathologie est vue comme inhérente au destin de l’existant humain appelé à devenir. » (Ibid.).
Dans cette perspective, Schotte développe une méthode d’analyse du pathologique qui devient chez lui un accès pour saisir la condition humaine (pathoanalyse). « Les maladies mentales sont ainsi comprises comme autant de moments « pathiques » qui traduisent le travail de l’humain, en souffrance d’humanisation. » (Ibid.) Cette approche du pathique se retrouvait déjà chez des psychiatres directement influencés par Husserl et Heidegger, comme Binswanger, Minkowski, Gebsattel, Straus et d’autres. Les études et relectures des grandes pathologies psychiatriques au prisme de l’anthropologie phénoménologique ont marqué Schotte de leurs empreintes.
« Parmi toutes ces influences, celle de Binswanger aura une importance décisive sur son projet d’anthropopsychiatrie. » (Ibid.) De ces rencontres avec le psychiatre suisse, Schotte a surtout retenu que si la psychiatrie doit être humaine, et concerner l’humain dans son projet existentiel, il n’est pas question qu’elle renonce à revendiquer un statut scientifique.
Ainsi, il va « tenter d’asseoir scientifiquement la psychiatrie dans une double direction : d’une part, établir une nosologie psychopathologique articulée, qui fait système, et d’autre part, donner à la psychiatrie, pensée comme science humaine, les fondements épistémologiques dont elle a besoin pour contenir l’hétérogénéité des disciplines qui la constituent et la morcellent. » (Ibid.)
Son projet se construit dans deux directions. La première direction, entend dépasser une nosographie purement symptomatique, pour laquelle le DSM fait figure de paradigme. Des nosographies qui juxtaposent des troubles, saisis « partes extra partes », sans lien essentiel entre eux. « La psychanalyse freudienne et la phénoménologie clinique ouvraient déjà quelques pistes dans ce sens, mais c’est particulièrement la rencontre de Léopold Szondi, psychiatre et psychanalyste hongrois, fondateur de l’analyse du destin (Schicksalsanalyse), qui va l’y aider. » (Ibid.).
Szondi (1893 – 1986) travaille au départ comme orthogéniste et s’intéresse à la question de la transmission psychobiologique des pathologies mentales. La psychanalyse notamment Freud, Jung, et Hermann, ont une influence sur son travail dans lequel, il construit progressivement une théorie de la personnalité, qui repose sur quatre vecteurs pulsionnels, dénommés Contactuel, Sexuel, Paroxysmal et Moïque ou Schizophrénique (Szondi, 1952). « Cette intuition szondienne d’un système pulsionnel, Schotte la considère comme géniale et d’une grande portée pour son entreprise visant à conférer à la psychiatrie un statut scientifique. Il va passer ainsi plus de 40 ans de sa vie à expliciter cette intuition, à en montrer le bien-fondé et à lui donner forme et rigueur. » (Ibid.)
Schotte remarque chez Szondi, comme dans l’œuvre de Freud, un « saut » qui va de l’analyse de la constitution (biomédical) à celle du destin, où l’homme s’accomplit en faisant des choix (choix amoureux, de métier, de maladie, d’idéaux culturels, etc.). « L’homme est alors d’emblée considéré dans une dimension psychique-anthropologique hors de l’instinct sexuel animal. » (op. cit., Escots, Duruz). Schotte considère que l’apport essentiel et novateur de Szondi réside dans « la dynamique pulsionnelle du sujet en fonction d’une structure, orientée selon quatre vecteurs et révélant quatre dimensions constitutives de la condition humaine. » (Ibid.).
Schotte a thématisé ces quatre vecteurs qui concernent chacun, dans un ordre croissant de complexité, une des problématiques essentielles de l’humain dans son travail d’humanisation, et que l’on peut schématiser ainsi :
« Le vecteur du Contact renvoie à la problématique du lien primordial de l’existant humain avec le monde à travers le sentir. L’expérience de l’ambiance, du rythme, de l’humeur, constitutive de la dimension esthétique de l’existence, se révèle de manière privilégiée dans les troubles thymopathiques. Le vecteur Sexuel renvoie, lui, à la problématique de la constitution du monde en objet. L’expérience du désir, de la séduction, à l’origine de la dimension pratico-technique de l’existence, se manifeste par excellence dans les troubles de la perversion. Le vecteur Paroxysmal concerne la problématique du positionnement sexuel-social de chaque existant confronté à la loi. L’expérience des affects violents de la crise et de leur dépassement dans la culpabilité et la convivialité, révélatrice de la dimension éthique de l’existence, se donne à voir en particulier dans les troubles de la névrose. Enfin, le vecteur Schizophrénique ou Moïque renvoie à la problématique de l’autoconstitution de soi. L’expérience des transformations identitaires, scellées dans les narrations de soi, est révélatrice par excellence de la dimension historico-dialogale de l’existence ; celle-ci se trouve atteinte de manière sélective dans les troubles de la psychose. » (Ibid.).
Pour Schotte, cette thématisation du schéma pulsionnel szondien, dégage un ensemble structuré-structurant des différentes problématiques humaines, articulées ensemble par des rapports de structure. Pour lui, cette nosologie renouvelée, cette grille de lecture pour une anthropologie clinique de l’existence humaine, légitime la psychiatrie à revendiquer son statut de science humaine.
La deuxième direction que poursuit le projet de Jacques Schotte dans son souci de préserver une « psychiatrie humaine de nature scientifique », a pour origine, selon lui, « le constat que les connaissances de la psychiatrie actuelle proviennent d’une pluralité de disciplines hétéroclites, sans articulation entre elles », si ce n’est à travers le prisme bio-psycho-social. (Ibid.).
La clinique se trouve face à une pluralité de modèles juxtaposés, où chacun cherche à exercer avec plus ou moins d’habileté une hégémonie sur les autres. Selon Schotte lui-même : « […] la psychiatrie va-t-elle donc enfin devenir une science autologique — autrement dit une discipline qui ait son propre logos ou manière de dire et de penser un objet qui devienne formellement le sien, une discipline unitaire qui ait en un mot sa scientificité spécifique —, ou bien va-t-elle rester une simple science appliquée à partir d’un agrégat de disciplines plus ou moins connexes ? » (Schotte, 2006, pp. 83 – 84). Le plus important pour Schotte, c’est de construire une science clinique humaine, qui garantisse la spécificité de son objet, c’est-à-dire la « différence anthropologique ». On retrouve ici, le « seuil différentiel » de Gagnepain, évoqué précédemment.
Une fois cela garanti, l’apport des sciences dites naturelles devient indispensable. Ainsi, « la phénoménologie n’a jamais contesté une place pour la psychologie expérimentale ou le comportementalisme, mais exige toutefois que la question posée à l’origine de leurs recherches ne fasse pas oublier le contexte de sens dans lequel elle s’inscrit. () Les discours étiologiques se nourrissent trop de modèles qui, dans leur hyperspécialisation et leur souci d’efficacité immédiate, tendent à fonctionner sur le mode d’une étio-idéologie, effaçant du même coup la question de l’homme souffrant, pourtant à l’origine de leur construction. » (Ibid.).
On repère dans le déploiement du projet de Schotte en quoi il constitue un socle épistémologique des plus abouti pour l’anthropologie clinique. Il ne se contente pas d’en appeler à des rapprochements entre clinique et anthropologie, ou à convoquer différentes approches psychanalytiques, phénoménologiques, structuralistes, il articule à la racine même du nouage entre bios et anthropos le pulsionnel et l’existentiel dans une structure qui contient le continuum de la santé et de la pathologie. Son anthropologie clinique propose les bases pour une alternative nosologique aux modèles nosographiques construits sur des ensembles de symptômes.
Nicolas Duruz et Serge Escots ont entrepris de reprendre à nouveaux frais la continuité du projet de Schotte en définissant pour l’anthropologie clinique un ensemble d’intentionnalité. Notamment, dans le prolongement du travail de Nicolas Duruz sur l’articulation épistémologique différentielle, en affirmant la vocation de l’anthropologie clinique à construire des champs conceptuels aptes à favoriser le dialogue entre différents modèles ou approches thérapeutiques (Duruz et al, 2002)[11]. Tout en recherchant dans les sciences neurobiologiques et neurophysiologiques des appuis pour construire ces champs conceptuels. L’inscription de cette entreprise dans les pas de Jacques Schotte, barre la voie à l’utilisation des neurosciences pour réduire les phénomènes humains au substrat cérébral. Au contraire, il s’agit dans cette nouvelle démarche pour l’anthropologie clinique de faire valoir les dimensions anthropologiques en jeu dans les apports des sciences naturelles.
Pour ce faire, Escots et Duruz vont faire appel à l’anthropologie sémiotique. En effet, toute articulation des sciences naturelles à une démarche anthropologique prend le risque de la naturalisation. C’est précisément l’enjeu épistémologique de l’anthropologie sémiotique : « culturaliser la cognition » ! Depuis une vingtaine d’années un groupe de chercheurs développent cette perspective en anthropologie à partir de différents domaines disciplinaires où il s’agit de traiter la question de l’articulation des sciences cognitives et des sciences de la culture. Cette approche repose à la fois sur la philosophie des formes symboliques de Cassirer, et sur une phénoménologie sémiotique proche de Merleau-Ponty, ainsi que sur une critique des modèles néodarwiniens de la cognition sociale et du langage, qui sont considérés dans le cadre de l’anthropologie sémiotique comme inadéquats. Parmi eux, Jean Lassègue, Victor Rosenthal et Yves-Marie Visetti ont posé les grandes lignes de l’anthropologie sémiotique définie comme champ d’étude de formes et activités symboliques, langagières, pratiques ou techniques, modélisé comme économie symbolique de systèmes complexes, dont les agents et les transactions assignent et transmettent des rôles et des valeurs qui conditionnent les interactions. Cela signifie que « les phénomènes sociaux humains n’émergent pas d’une interaction entre des individus dont les buts et les modes d’actions seraient préprogrammés »[12] (Lassègue et al, p. 72), pas plus que la dimension symbolique ne relève d’une compétence individuelle, qui résulterait d’une « capacité cérébrale couplée à des contraintes environnementales » (Ibid.). Considérant comme décisifs les enseignements de l’anthropologie et de la linguistique structurale, les auteurs soutiennent que « le destin d’un signe se joue dans des registres aussi bien fictionnels que pratiques, tandis que sa signification se détermine dans une association différentielle à d’autres, et dans la “traduction” vers d’autres ensembles de signes » (Ibid., p. 74). Pour eux, « ce sont les pratiques sémiotiques qui suscitent et organisent l’expérience » (Ibid.). Cet énoncé est à saisir, en fonction de trois postulats qu’ils formulent ainsi :
- « Toute expérience subjective, toute perception est d’emblée sémiotique » (Ibid., p. 95) ;
- Cette médiation sémiotique de l’expérience et de la perception est indissociable de formes et de valeurs qui en sont l’objet ;
- Ces formes et valeurs ne se conçoivent qu’à l’intérieur « des transactions sociales qui les portent à l’existence » (Ibid., p. 96).
Avec le caractère d’emblée social de la cognition et la remise en cause du référentialisme dans les théories du langage, l’anthropologie sémiotique offre ainsi une voie alternative aux modèles neurocognitivistes dominants, grâce à laquelle il devient possible de penser des continuités entre phénoménologie biologique et socioculturelle, plus précisément de trouver de nouveaux régimes d’explications à des phénomènes dans l’entrelacs du corps, de l’expérience subjective, du social et des discours. Pour ces auteurs, « c’est dans un rapport singulier à un environnement, qu’il configure en même temps qu’il s’y forme, que l’être vivant se détermine »[13] (Visetti et Rosenthal, 2006, p. 115).
Cette conjonction du projet de Jacques Schotte avec celui de l’anthropologie sémotique a permis à Escots et Duruz de proposer un nouvel ensemble structuré-structurant qui articule les niveaux somato-neuropsychique et sémiotique entre les dimensions anthropologiques et les grandes catégories de manifestations psychopathologiques[14].
Serge Escots
[1] Duruz, N. (2008). Anthropologie clinique, psychopathologie et psychothérapie. Le Journal des psychologues, 258(5), 18-21.
[2] {Lekeuche, P. (2008). Jalons pour une anthropologie clinique : Actes enrichis du Colloque international « Psychopathologie et psychothérapie au regard de l’anthropologie », Lausanne, 3-5 novembre 2005, in « PSN : Psychiatrie, Sciences humaines, Neurosciences », vol. 5, supplément 1, Springer, juin 2007. Cahiers de psychologie clinique, 30(1), 221-224.}
[3] Trembley M.A., L’anthropologie de la clinique dans le domaine de la santé mentale au Québec. Quelques repères historiques et leurs cadres institutionnels, 1950-1990, Sociologie Santé, juillet 1991, n°4, 53-80.}
[4] Il conviendrait plutôt de parler de tradition sociologique de Chicago que d’école de Chicago (Chapoulie, 2001, Topalov, 2003)
[5] Escots, S. & Duruz, N. (2015). Esquisse d’une anthropologie clinique: I. Anthropopsychiatrie et anthropologie sémiotique. PSN, volume 13(3), 27-52.
[6] Douville, O. (2013). Histoire et situations contemporaines de l’anthropologie clinique. Cahiers de psychologie clinique, 40(1), 217-244.
[7] Freud S., Totem et tabou, Payot, 1980, p. 6
[8] Assoun P.L., Inconscient anthropologique et anthropologie de l’inconscient. Freud Anthropologue., Revue du MAUSS, La Découverte, 2011, p. 74.
[9] Dans la perspective de « Transdisciplinarité. Manifeste » de Basarab Nicolescu, Éditions du Rocher, 1996.
[10] Steichen, R. (2004). Une anthropologie d’inspiration psychanalytique parmi les sciences humaines cliniques ?. Le Coq-héron, no 176(1), 59-74.
[11] Duruz N., Gennart M., (sous la direction) Traité de psychothérapie comparé, Médecine et Hygiène, 2002.
[12] Lassègue J., Rosenthal V., Visetti Y-M., Économie symbolique et phylogénèse du langage, l’Homme, 2009/4-192.
[13] Visetti Y.-M., Rosenthal V. (2006) : Les contingences sensorimotrices de l’énaction, Intellectica, 2006/1, 43, pp. 105-116.
[14] Escots S., Duruz N., Esquisse d’une anthropologie clinique II, Les comportements psychopathologiques comme formes de vie, pensés à l’articulation du fonctionnement neurobiologique, de l’intériorité subjective et des formes symboliques., Psychiatrie, sciences humaines, neurosciences, 2015/4, vol 13, pp 41-74, Éditions matériologiques.