Actualités de l'institut d'anthropologie clinique
Loïc Mansuela - 22 janvier 2025
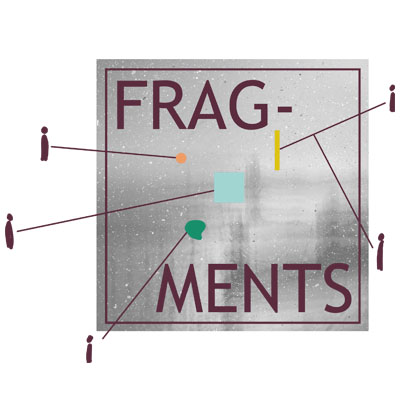
FRAGMENTS#6 – Charles BUKOWSKI, « Ce sang qui coule dans mes veines ».
Charles BUKOWSKI, « Ce sang qui coule dans mes veines ».
Ces adjectifs qu’on laisse parfois traîner aux abords de la tête des enfants quand on leur parle de leur parent.
Temps de formation, avec un groupe de 9 professionnels, de fonctions et d’habilitations diverses, dans le champ de la protection de l’enfance. Un débat s’amorce. Il concerne un conflit de valeurs qui les saisit parfois lorsqu’ils accompagnent certains enfants, dont les parents, particulièrement empêchés, exposent ceux-ci à des situations relationnelles particulièrement compliquées, si ce n’est, selon eux, clairement inadaptées. Concernant la situation dont nous sommes en train de parler, une éducatrice affirme alors, résolue, qu’il faut nommer explicitement les « dysfonctionnements » parentaux à l’attention des enfants, afin qu’ils puissent s’en « détacher », et accepter de façon plus collaborative les aides proposées.
Les référentiels traitant des besoins fondamentaux nous rappellent que ces enfants, dont certains sont âgés, voire presque majeurs, ont besoin de « s’inscrire dans une filiation », « dans une succession de générations », « de se raconter et se faire raconter (leur) histoire ainsi que celle de (leur) famille et de l’ensemble de (leur) environnement » ; ils nous rappellent aussi, le cas échéant, certains besoins spécifiques : besoin « d’explications claires sur les motifs du placement », besoin « de donner sens aux décisions et mesures », ainsi que « besoin que les modalités de relation avec la famille et (leur) entourage soient définies en accord avec l’identification de (leurs) besoins » (IAC, Evaluer la pourvoyance des besoins de l’enfant).
Tout cela pourrait tendre à faire penser qu’ils auraient effectivement le droit de savoir ce qu’il en est de ces empêchements parentaux ; Qu’ils mériteraient, voire auraient besoin, que l’on mette des mots clairs sur ces empêchements ; qu’on les qualifie de telle sorte à ce qu’ils puissent se les représenter, et se différencier, gagner en pouvoir de désaliénation et en capacité d’investissement d’autres figures d’attachement.
A quoi cela reviendrait-il, de « nommer les choses telles qu’elles sont », concernant ces parents « déconnants », « défaillants », « violents », « fous », « néfastes »… pour leurs enfants ? Après tout, ces enfants n’ont-ils pas le droit de savoir ? Cette qualification ne fait-elle d’ailleurs pas partie du processus de soin ? : soigner un enfant, n’est-ce pas aussi qualifier ce qui le fait ou l’a fait souffrir, afin de lui redonner son statut de victime ?
Je grossis un peu le trait, pour permettre la réflexion, mais il est question quelque part de cet impératif de nommer le mal, de lui donner un nom. Dans les faits, le mot, qui ressort souvent, pour qualifier ces parents, c’est celui de toxique*.
Preuve en est, dans le monde des mots qui nous environnent, les emplois de l’expression « parents toxiques » sont pléthoriques. Internet l’illustre : Parent toxique sans le savoir ? Faites le point – Fondation Jeunes en Tête.org ; Qui sont les parents toxiques ? – Psychologue Paris7.fr ; Parents Toxiques@parentstoxiques– instagram, 53,4 K abonnés ; Parent toxique : 5 conséquences sur votre vie d’adulte – la clinique E-Santé.com ; Mes parents sont-ils toxiques ? 10 signes pour le savoir – ELLE.fr, psycho et sexo news ; Parents toxiques : les 7 signes pour les reconnaître – psychologue.fr ; Comment reconnait-on un parent toxique – TF1 Info ; Education : Ce qui caractérise les parents toxiques – BBC.com ; Parents toxiques, Comment échapper à leur emprise – FNAC.com. ; … pour ne citer que la 1ère page google-isée à l’emporte-pièce.
Le terme est donc largement entré dans le langage courant. Que ce soit pour qualifier un parent, ou un∙e compagnon∙e, l’adjectif toxique a le vent en poupe, et cela favorise la dénonciation, par les victimes concernées, de ce qu’elles vivent parfois dans un huis-clos familial et/ou conjugal. Rendre l’affaire « publique », en la nommant, est parfois une étape indispensable au cheminement vers la désemprise. Ce dont on ne peut pas ne pas se réjouir, c’est de cette avancée sociétale à laquelle nous assistons, quant aux outils, y compris outils à penser, donc des mots, des expressions, disponibles pour accompagner le tout un chacun dans la description d’une relation qui le fait souffrir. On comprend la logique : la dénomination de l’éventuelle toxicité de son parent peut aider certains enfants à donner du sens, à leur vécu, et leur permettre de construire une explication tangible quant à ce qui leur aura été donné de vivre. Ceci est admis.
Le travail de la loi n’est pas en question ici, elle doit prendre sa part. Ce qui nous intéresse est un point peut-être aveugle au niveau clinique : Si les professionnels cèdent à cette tentation, dès qu’elle s’impose à eux comme une nécessité, de nommer le parent de toxique quand il leur paraît l’être, quels autres effets cela peut-il produire. Que peut-il aussi se passer d’autre, quand ce qualificatif est émis en direct dans l’oreille de l’enfant ?
Déjà, on devrait préciser, ceci est frappé au coin du bon sens, que tout cela est conditionné à une multitude de paramètres : l’âge de l’enfant, sa connaissance acquise du fonctionnement parental et familial, son niveau de compréhension, etc. Mais surtout, un choix précis des mots utilisés s’impose, pour pointer le problème parental – comment faire en sorte que le parent ne soit pas essentialisé, et réduit à des tares que l’on plaquerait sur lui ? Pourquoi ? Tout d’abord parce que, même si le terme n’est pas employé tel quel, explicitement, le considérer, le penser, ce parent, comme étant de nature toxique, c’est-à-dire pleinement, intégralement, va limiter le champ des possibles quant à nos possibilités de travailler avec lui. En effet, dans la très grande majorité des situations accompagnées dans le cadre de la protection de l’enfance, les parents restent dans la partie. Comment les représentations essentialistes des professionnels impliqués dans cette relation avec ces parents peuvent impacter leurs possibilités d’alliance avec eux ? Notons que dans tous les cas évoqués ici nous avons parlé de Parents toxiques, et non de Relation toxique, or la nuance est de taille.
De plus, ces enfants sont, qu’on le veuille ou non, attachés à leurs parents. Ils sont, d’une manière ou d’une autre, liés à eux, par le nom, par l’histoire, par le sang… Aussi, lorsque nous utilisons des adjectifs dépréciatifs et catégoriques sur leurs concepteurs, comment ces enfants peuvent-ils s’envisager eux-mêmes ? Sinon, potentiellement, comme l’engendrement de monstres, et donc comme des monstres eux-mêmes. Comment se construire, s’envisager, en tant qu’être humain, quand s’est construit en nous un imago parental rebutant, détestable, voire inhumain ?
Ceci n’est qu’un fragment, aussi il s’achèvera sur cette (encore une) question : que se passe-t-il lorsqu’on laisse traîner aux abords de la tête d’un enfant des termes discréditants, dépréciatifs ou disqualifiants à propos de l’un de ses parents voire les deux ? En quoi cela les aident-ils, ou non, à s’extraire du collage ou du clivage vis-à-vis d’eux ?
Le hasard faisant bien les choses, je tombe, peu de temps après cette formation évoquée en préambule, sur cet extrait d’un poème de Charles BUKOWSKI, écrit à propos de son père :
« C’était un salaud, un lâche, et son sang est aussi le mien. Parfois, j’ai l’impression d’être comme lui. Et quand je discute avec une femme ou quelque chose du genre, je me sens merdique, nul, et je sais que je vais agir comme un salaud. Et parfois je pense que c’est à cause du sang de mon père qui coule dans mes veines. Du sang de traître en moi. Ça fait mal. »
Peut-être à suivre…
* voir aussi, sur ce sujet, En finir avec les parents toxiques, Serge ESCOTS, Lola DEVOLDER, Carré de Vignes édition, 2016 – L’essentiel de cet argumentaire y apparait déjà. Version en ligne sur le site de l’IAC.