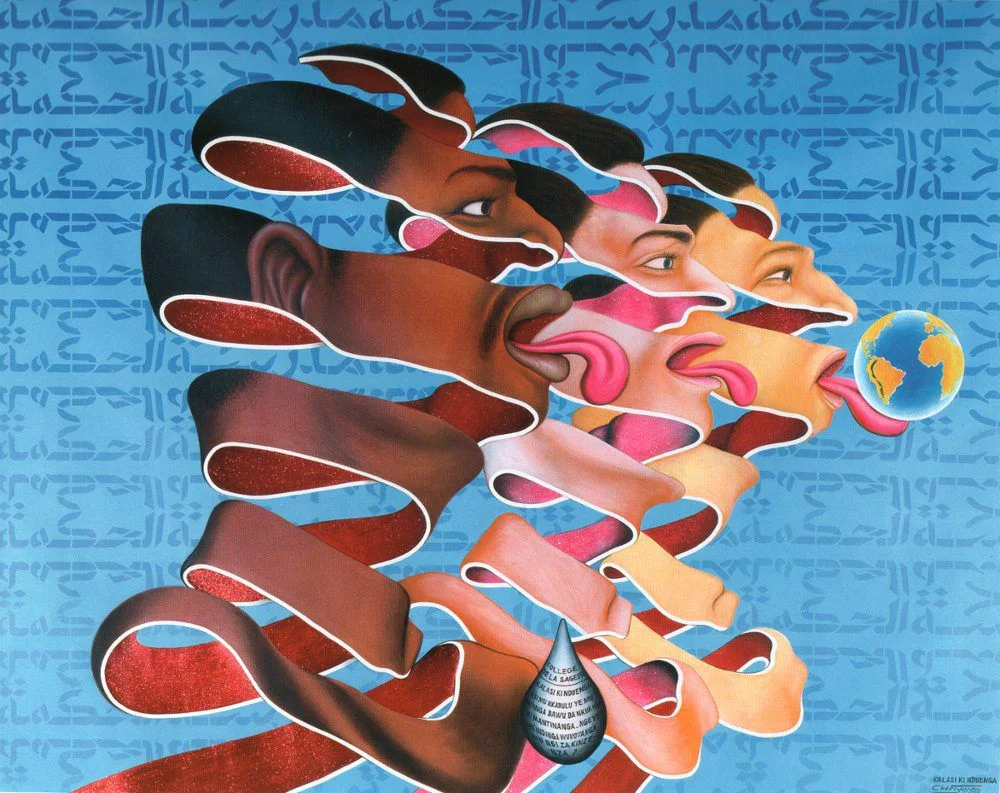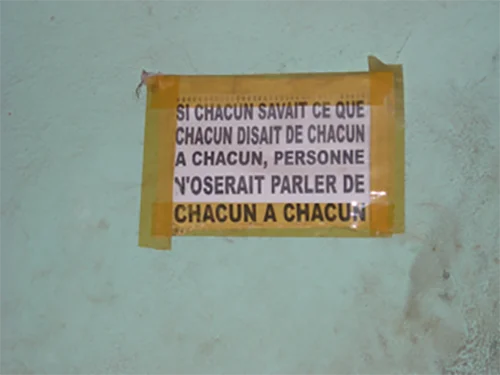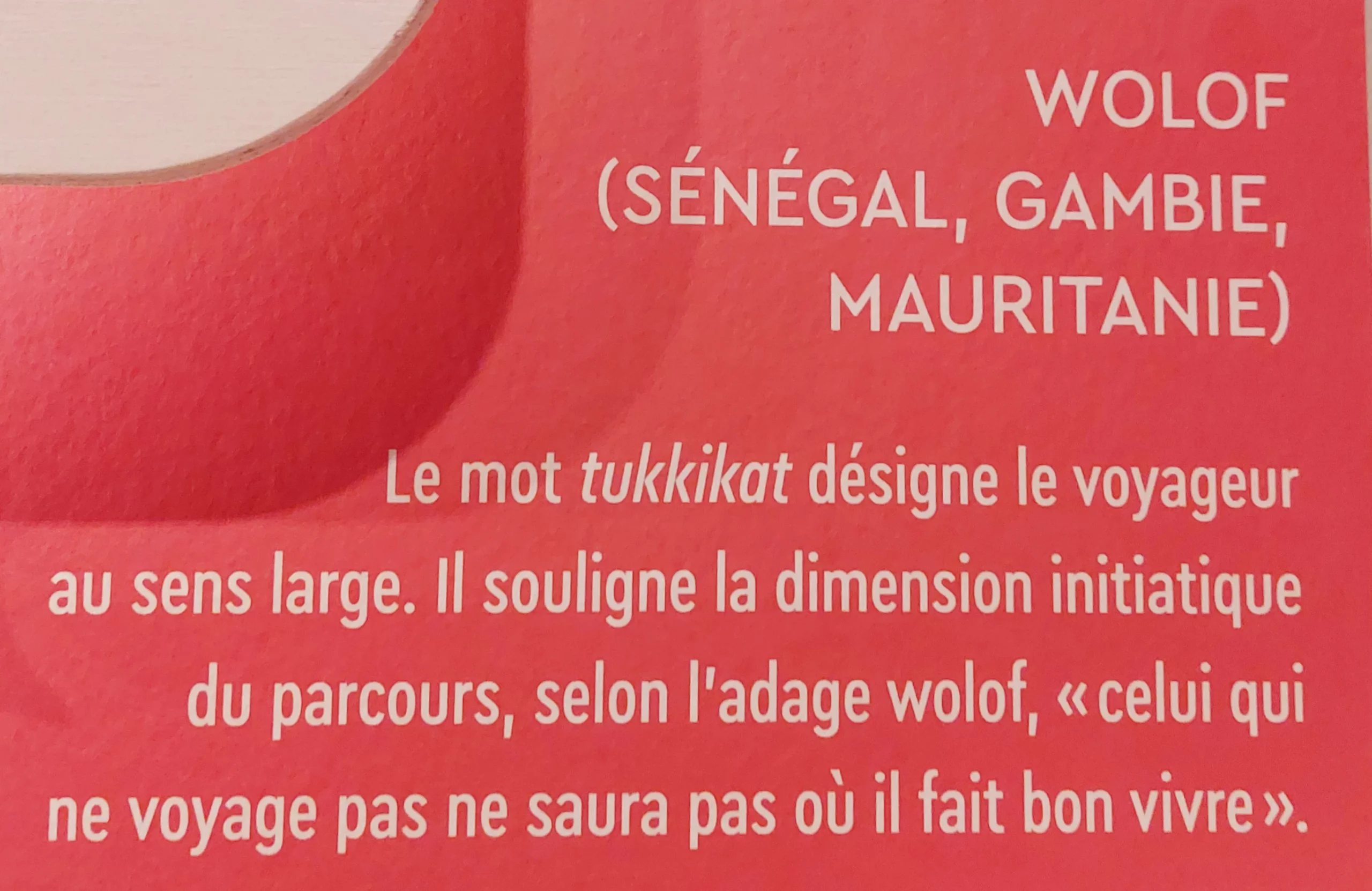A l’IAC, la clinique de l’exil s’inscrit progressivement dans la perspective de l’anthropologie clinique. Les voies de l’archipelisation et de la créolisation des modèles empruntées par l’anthropologie clinique, rejoignent notre pratique de la clinique de l’exil.
En effet, nous pensons que les expérience humaines, examinées par les courants théorico-clinique de cette clinique, sont infiniment diverses. Soucieux d’arrimer l’hospitalité à notre posture clinique auprès des patients et à nos activités d’accompagnement des professionnel·l·es, nous recherchions une vision intégrative et interdisciplinaire.
Le cadre de la clinique de l’exil expérimenté à l’IAC s’appuie sur les recherches en anthropologie, en psychanalyse, en psychologie interculturelle, en clinique transculturelle, en clinique du traumatisme, en thérapie familiale d’inspiration systémique et contextuelle. Devant l’ampleur des problématiques rencontrées par les personnes accompagnées et les professionnels, cette pluralité de modèles soutien et consolide notre activité de formation et de supervision.
Formation
En tant que psychologue clinicien en centre d’accueil de demandeurs d’asile pour mineurs non accompagnés de 2008 à 2015, j’ai été sollicité depuis 2012, pour animer des formations cliniques auprès des travailleurs sociaux œuvrant auprès des jeunes migrant.e.s. En effet, depuis 2013, une grande diversité des modalités d’accueil des MNA en France a été mise en place. La dimension clinique de l’accompagnement de ces jeunes ne constituant que très rarement une priorité pour les instances décisionnaires, les besoins des professionnel.les de réfléchir à partir de la complexité interculturelle rencontrée sur le terrain ont donné lieu à de nombreuses demandes de formation professionnelle et d’accompagnement de pratiques professionnelles.
Approfondissant ces premières expériences auprès des équipes, nous avons proposé à l’IAC une formation généraliste intitulée « sensibilisation à la clinique de l’exil ».
Par la suite, en lien avec mes nouvelles expériences institutionnelles (poste à la pouponnière du CDEF31 durant 6 ans), la dimension familiale du travail auprès des personnes accompagnées s’est révélée incontournable. J’ai donc ajouté à mes intérêts pour la clinique de l’accueil des personnes migrantes, l’élargissement aux champs familiaux et conjugaux. Cette approche systémique et transculturelle étant malheureusement absente des formations initiales des soignants et des travailleurs sociaux, la formation professionnelle à l’IAC offre un module intitulé « Approche systémique des situations familiales et conduites d’entretien pour des publics en souffrance psychique liée à des situations d’exil ».
Depuis 10 ans, nous accompagnons dans le cadre de la formation, les professionnel·les qui s’interrogent sur leurs pratiquent auprès des familles et des personnes isolées en situation d’exil.
- Sensibilisation à la clinique de l’exil
- Approche systémique des situations familiales et conduites d’entretien pour des publics en souffrance psychique liée à des situations d’exil
Dispositifs cliniques
L’activité clinique de l’IAC s’affirme également dans le champ de la clinique de l’exil. Cela se traduit par différents dispositifs, caractérisés par un travail de collaboration avec les interprètes : les consultations de thérapie familiale libérales, les dispositifs institutionnels organisés autour des demandes émanant des professionnels en présence des familles accompagnées.
L’animation de ces dispositifs s’appuie sur nos activités de thérapeute de famille, formé à l’approche systémique et à la clinique transculturelle. Au lieu de s’attarder sur les différences entre certains points théorico-cliniques qui nous empêcheraient dogmatiquement de circuler sereinement au sein de courants distincts, nous repérons au contraire, les bénéfices de l’approche intégrative, qui augmente notre capacité à puiser au sein des différents modèles théoriques et psychothérapeutiques.
Il est passionnant de repérer les articulations possibles entre ces différents modèles. Ainsi, la présence en psychothérapie pour traiter les symptômes d’un enfant, des membres du plus petit système dans lequel s’inscrit l’individu, c’est-à-dire sa famille, représente une configuration de travail requise par les thérapeutes systémiciens. Dans des perspectives ethnopsychanalytiques ou transculturelles, ces dispositifs groupaux se pratiquent depuis plusieurs décennies en France.
De même que lors de nos stages à l’Hôpital psychiatrique de Bamako au Mali (où il n’est pas possible d’hospitaliser une personne sans accueillir durablement en chambre un parent de la famille !), nous avons constaté le traitement psychothérapeutique établi lors de séances de thérapie familiale hebdomadaire.
Notre expérience de terrain comme psychologue en établissement accueillant des personnes exilées (MNA ou familles demandeuses d’asile), nous a amené à nous inspirer de ces dispositifs. Le système d’aide composé des personnes accompagnées et des accompagnants était alors reçu, ces derniers étant en amont soutenus et invités à assumer une parole adressée au psychologue à propos de leurs authentiques soucis concernant les personnes accompagnées. Ceux-ci découvrant grâce à cette triangulation concrète, le type de portage psychique opéré par les professionnels.
Nous continuons à pratiquer cet exercice clinique dans le cadre des dispositifs de médiation sur site. Nous nous déplaçons ainsi avec un·e interprète sensibilisé·e à ces techniques, dans les structures (MECS, MDS, CADA, CPH) dont les professionnel.les sollicitent ce dispositif, convaincu·e·s que les difficultés de communication émanent de la situation d’exil dans laquelle se trouve les usagers.
Une supervision collective s’est mise en place dans les locaux de l’IAC tous les deux mois, donnant la possibilité aux professionnel·les de venir interroger leurs pratiques auprès d’usagers en situation de migration.
Par ailleurs, nous sommes régulièrement sollicités pour accompagner des équipes ponctuellement et penser avec eux certaines situations qui les interrogent sur les plans culturels et interculturels. La clinique de l’exil à l’IAC constituant un cadre de réflexion intégratif pour échanger entre professionnel·les, les différents modèles théorico-cliniques des professionnel.les sont invités à dialoguer pour dégager de nouvelles pistes de travail régénérant au sein des équipes.
études & recherche
En 2024, une étude a été mise en place grâce à des financements de la Fondation de France qui ont rendu possible à une collaboration de l’IAC avec les services CADA, HUDA et CPH de l’UCRM.
En cohérence avec les activités de l’IAC auprès des personnes accompagnées et accompagnantes, cette étude interroge les rencontre interculturelles entre ces différents acteurs et l’efficacité soignante des liens d’alliance interpersonnels et interdisciplinaires.
D’une part, cette recherche porte sur l’alliance entre les interprètes et les professionnels. Le dimension expérientielle de cette recherche permet aux professionnels qui participent aux dispositifs cliniques, de réfléchir leurs modalités de travail avec les interprètes.
Il s’agit d’une relation complexe qui est peu pensée hors des champs de la clinique transculturelle. Pour nous, les modalités d’interaction entre ces acteurs constituent un domaine d’exploration extrêmement stimulant. En effet, nous faisons l’hypothèse de l’existence d’un lien entre la valeur clinique des rencontres pro/usagers migrants et le type de liens unissant ces acteurs.
D’autre part, cette étude nous permet d’interroger l’utilisation, auprès du système relationnel usagers/professionnels, de techniques d’animation d’entretien issus de différents modèles de thérapies familiales auprès du système relationnel usagers/professionnels.
Nous découvrons ainsi les apports relatifs aux contenus des relations interpersonnelles permis par la rigueur qu’impose l’utilisation de règles de métacommunication. En ce sens, nous faisons une nouvelle hypothèse qui relie les contenus enculturés chez les usagers en situation pré migratoire, à propos des dispositifs de communication connus lorsqu’il est question de l’inquiétude de certains membres de la communauté au sujet du développement d’un enfant ou d’un désordre dans les relations, avec le cadre de l’accueil, inspiré par les différents modèles de thérapies familiales auxquels nous nous référons.
Le dispositif a d’ailleurs été nommé « médiations cliniques : expérimenter en relation la partialité multidimensionnelle transculturalisée »
Médiagraphie
Amselle, J-L. (2011). L’éthnicisation de la France. Nouvelles Editions Lignes.
Bonnet, D. et Pourchez, L. (dir.). (2021). Du soin au rite dans l’enfance. Eres.
Bricaud, J. et Crombé, X. (dir.). (2020). Jeunes migrants : le temps de l’accueil. Points de rencontre, points de passage. Editions de la Chronique Sociale.
Bossuroy, M. (dir.). (2016). La psychologie clinique transculturelle. Editions In Press.
Davoudian, C. (dir.). (2012). Mères et bébés sans-papier. Une nouvelle clinique à l’épreuve de l’errance et de l’invisibilité. Editions Erès.
Devereux, G. (2009). La renonciation à l’identité. Défense contre l’anéantissement. Editions Payot & Rivages.
Devereux, G. (1980). De l’angoisse à la méthode. Flammarion.
Favret-Saada, J. (1977). Les mots, la mort, les sorts. Editions Gallimard.
Ferradji, T. (2009). Ces exils que je soigne. La migration d’un enfant de Kabylie. Les éditions de l’Atelier/ Editions Ouvrières.
Gaultier, S., Yahyaoui, A., Benghozi, P., Baubet, T. (dir.). (2023). Mineurs non accompagnés. Repères pour une clinique psychosociale transculturelle. Editions In Press.
Jamoulle, P. (2013). Par-delà les silences. Editions La Découverte.
Kobelinsky, C. (2010). L’accueil des demandeurs d’asile. Une ethnographie de l’attente. Editions du Cygne.
Laacher, S. (2018). Croire à l’incroyable. Un sociologue à la Cour du droit d’asile. Éditions Gallimard.
Laplantine, F., Nouss, A. (2001). Métissages. De Arcimboldo à Zombi. Editions Pauvert.
N’Koussou, G. (2014). Enfants soldats… enfants sorciers ? Approche anthropologique dans l’Afrique des Grands Lacs. L’Harmattan.
Lioger, R. (2002). La folie du chamane. Histoire de l’enthnopsychanalyse. PUF (1ère ed.).
Mavinga Lake, D. (2019). L’enfant sorcier et la psychanalyse. Editions Erès.
Mestre, C. (dir.). (2016). Bébés d’ici, mères d’exil. Editions Erès.
Métraux, J-C. (2004). Deuils collectifs et création sociale. La Dispute.
Métraux, J-C. (2017). La migration comme métaphore. La Dispute (3ème éd.).
Moro, MR. (2002). Enfants d’ici venus d’ailleurs. Naitre et grandir en France. Editions La Découverte.
N’Koussou, G. (2014). Enfants soldats… enfants sorciers ? Approche anthropologique dans l’Afrique des Grands Lacs. L’Harmattan.
Nathan, T. (1994). L’influence qui guérit. Odile Jacob.
Nathan, T. (2001). Nous ne sommes pas seuls au monde. Les empêcheurs de penser en rond.
Nathan, T. (2017). Les âmes errantes. L’iconoclaste.
Pestre, E. (2010). La vie psychique des réfugiés. Editions Payot & Rivages.
Reveyrand-Coulon et O., Guerraoui, Z. (dir.). (2006). Pourquoi l’interdit ? Regards psychologiques, culturels et interculturels. Erès.
Sironi, F. (1999). Bourreaux et victimes. Psychologie de la torture. Odile Jacob.
Saglio-Yatzimiesky, M-C. (2018). La voix de ceux qui crient. Rencontre avec des demandeurs d’asile. Éditions Albin Michel.
Sironi, F. (1999). Bourreaux et victimes. Psychologie de la torture. Odile Jacob.
Schmid-Kitsikis, E., Puyuelo, R. (dir.). (2022). Des psychanalystes racontent l’exil. Editions In Press.
SOS Meditérrannée, Rajablat, M. (2017). Les naufragés de l’enfer. Témoignages recueillis sur l’Aquarius. Editions Digobar.
Tison, B. et Leconte, J. (dir.). (2018). Mineurs étrangers non accompagnés. Dires et réflexions de psychologues. L’Harmattan.
Tomkiewicz, S. (1999). L’adolescence volée. Calmann-Lévy.
Veuilllet-Combier, C. (dir.). (2022). Familles et transmission à l’épreuve de la migration. Editions In press.
Petit-Jouvet L., J’ai rêvé d’une grande étendue d’eau, Documentaire, 2002
Yahyaoui A., Approche familiale transculturelle intégrative, Congrès EFTA CIM. IAC – Pratiques actuelles avec les familles, 2018
Saglio-Yatzimirsky M.-C., Temps du trauma, terre de l’asile, Collège de France – Colloque Migrations, réfugiés, exil, 2016
Gaultier S., Coconstruction du soin psychique et mineurs non accompagnés, Orspere-Samdarra, 2023
Roisin J., Clinique de l’exil à l’institut d’anthropologie clinique – Le dispositif de médiation, ODPE 2025
Petit-Jouvet L., La ligne de couleur, 2014